LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET
TECHNIQUE
COMME « IDEOLOGIE »
Face au diabète d’un proche, au mode
d’emploi d’une imprimante,
à une règle de trois ou aux risques Seveso,
serons-nous toujours infantilisés par les savoirs scientifiques ?
Article à paraitre
dans la revue Alliage n°59, 2006 - Nice.
Olivier Las Vergnas ( http://enviedesavoir.org
)
Précaution liminaire :
Les lignes qui suivent proposent le regard clinique d’un praticien impliqué dans l’animation et la médiation scientifique depuis un peu plus de trois décennies. Au delà de mes propres actions ou engagements, elles font fréquemment référence aux opinions et écrits de nombreux autres acteurs, décideurs et observateurs. Si la posture choisie dans ce texte conduit par principe à s’interroger – a posteriori – dans la durée sur les questions de cohérence et de persévérance, il doit être compris que l’intention n’est jamais de mettre en cause telle ou telle personne physique. Bien au contraire, nous pensons que les acteurs et auteurs cités ici se sont tous engagés et impliqués dans leurs projets et écrits avec une fougue qui force le respect, mais que chacun d’entre nous se heurte systématiquement à un contexte social, économique et culturel de nature à faire dériver les plus nobles intentions, affaiblir le plus grand enthousiasme ou fragiliser le plus intéressant des programmes d’action. Ce ne sont donc pas les personnes qui sont à mettre en cause, mais bien le contexte dont on ne prend souvent conscience qu’à posteriori, en observant ethnologiquement des bégaiements de l’histoire contemporaine.
A : Balbutiement des discours,
Consensus mou des intentions
Traduire ce qu’à voulu dire son médecin à un proche, choisir un isolant pour mansarder un grenier, comparer le coût de plusieurs crédits, prendre part à une consultation locale sur un projet d’éoliennes, savoir quand commence le Ramadan, installer la TNT, limiter sa consommation d’antibiotiques, économiser du gazole en le coupant avec de l’huile de tournesol, déterminer la meilleure heure pour aller à la pêche aux couteaux ou voir des étoiles filantes, chercher à comprendre pourquoi un cabinet de recrutement vous demande votre signe du zodiaque, sans parler d’aider un lycéen à faire son devoir de maths ou de penser du bien ou du mal d’ITER ou du retour de l’homme sur la Lune, les besoins d’utilisation de savoirs scientifiques peuvent être quotidiens.
Plus fondamentalement encore, pour qui milite pour la démocratie, le libre arbitre et les autres formes d’empowerment[1] individuel et social, contre les obscurantismes et autres oppressions intellectuelles de toute nature, donner à chacun la capacité de distinguer croyances, convictions et savoirs étayés s’avère une nécessité. A ce titre, la construction et l’appropriation de savoirs et de méthodes de résolution de problèmes comme ceux qu’apporte la pensée scientifique sont des enjeux cruciaux du développement harmonieux de nos sociétés.
Cependant, malgré l’institutionnalisation de la « fête de la science », le développement d’un réseau de centres de culture scientifique en France et la multiplication des actions et structures locales, la majorité de nos concitoyens se sent largement démunis s’ils doivent mobiliser des savoirs ou méthodes scientifiques pour résoudre un quelconque problème. Est-ce à dire que l’action culturelle scientifique que nous développons dans de multiples cadres depuis trois décennies est socialement inopérante ? Doit-on en conclure qu’il est illusoire d’espérer une appropriation généralisée de l’esprit et des raisonnements scientifiques ?
Pourtant, de multiples expériences montrent qu’il est tout à fait possible de donner durablement l’envie et les moyens à n’importe quel petit groupe de s’approprier des méthodes scientifiques, pourvu que l’on y consacre suffisamment d’énergie, en partant par exemple de centres d’intérêts ou de curiosité des individus (téléchargement mp3, jeux sodoku, cerf-volant, voile, cosmogonie, bien-être, musique, archéologie…). Les projets de jeunes qui sont régulièrement présentées dans les exposciences impulsées par le collectif d’associations d’éducation populaire Cirasti en témoignent[2]. Pourtant, la vague d’enthousiasme actuelle pour les jeux de chiffres « Sodoku », rappelant la déferlante du Rubik’s Cube, laisse percevoir que l’envie de réfléchir n’est pas seulement l’apanage de l’élite. N’oublions pas non plus l’engouement suscité dans une majorité de la population par la possibilité d’observer l’éclipse du 11 août 1999 !
Alors, comment expliquer que l’intérêt pour les sciences et l’esprit scientifique ne progresse pas plus ? Comment se fait il que la curiosité, les pratiques de découverte scientifique ne fassent pas progressivement tache d’huile ? Comment expliquer que les sciences et leurs méthodes n’occupent pas une part plus importante dans l’éducation populaire, la vie quotidienne, bref la culture de tous ? Certes, le développement et la présentation de son projet scientifique ou technique dans une exposcience nécessite un fort soutien pédagogique de proximité et ne concerne donc que quelques milliers d’individus par an, ceux pour lesquels les moyens de cette action de proximité existent. Mais, bien d’autres pratiques, moins coûteuses en animation locale peuvent être développées, et surtout, si les enjeux de « la science pour tous » sont jugés si cruciaux, les moyens consacrés devraient être démultipliés.
Justement, voici qu’en France, le Sénat, l’assemblée nationale et le gouvernement viennent coup sur coup d’examiner cette question de la « culture scientifique pour tous ». Trois textes officiels récents prônent ainsi la nécessité de son développement et en affirment la « priorité nationale » (Rapports du Sénat Renar-Blandin et du député Hamelin, plan du Ministre de la Culture J.-J. Aillagon[3]). Ces trois textes s’inquiètent du manque de goût pour les sciences et de « culture scientifique » du plus grand nombre, confirmant ainsi implicitement la faible efficacité sociale des actions passées ou en cours.
Ces auteurs répètent ainsi des constats et des intentions déjà maintes fois entendus en France depuis 30 ans. Or, de fait, force est de constater que ces discours et les programmes et dispositifs qui en sont issus n’ont pas pour l’instant réussi à « mettre la science en notre culture générale ». Comme de plus, ces auteurs semblent ignorer qu’ils s’inscrivent dans une telle répétition, ils ne peuvent donc chercher à comprendre pourquoi toute ces énergies se sont révélées inadaptées à produire la transformation socioculturelle globale qu’ils appellent de leur vœux : Argumentaires classiques sur le bien fondé et l’urgence de telles politiques culturelles et actualisation de programmes d’actions n’ayant produit que des effets marginaux jusqu’alors, ces textes ne cherchent en rien à mettre au jour les éventuels invariants qui brident leur efficacité sociale depuis trois décennies. Donnant la parole aux scientifiques eux-mêmes, aux enseignants et développeurs d’offres de l’action culturelle scientifique et non à ceux qui pourraient exprimer des besoins ou malaises vis-à-vis des sciences (associations de malades, syndicats, unions de consommateurs), ces textes n’apportent pas de données quantitatives nouvelles ou d’évaluations critiques, mais reprennent les professions de foi prononcées à plusieurs reprises en France depuis trente ans. Le rapport au système d’éducation formelle est aussi paradoxal : même si ces textes évoquent la nécessité d’une amélioration de l’enseignement des sciences au collège ou au lycée, ils n’explorent réellement ni les moyens de le réformer en profondeur, ni les obstacles s’opposant à une telle réforme. Pourtant, c’est là que le plus grand nombre d’entre nous est confronté aux sciences et donc là où une forte proportion n’apprendra finalement qu’à les délaisser.
Comment interpréter une telle posture qui s’intéresse à la part de science dans la culture générale, mais pas au système qui, de loin, en est le plus responsable ? Faut-il voir là la crainte d’une illégitimité des auteurs de rapports sur « la culture » à s’immiscer au cœur du système éducatif formel ? Ou s’imaginent-ils pouvoir changer le statut et la représentation des savoirs scientifiques dans la culture générale de nos concitoyens sans transformation radicale de ce système éducatif, considérant qu’une telle évolution culturelle serait sensée s’accomplir dans le seul cadre de « temps libres » que chacun choisirait d’y consacrer ? Sachant que l’enseignement échoue à donner le goût des sciences au plus grand nombre malgré plusieurs heures dédiées à leur étude chaque semaine, voilà qui parait bien présomptueux, d’autant qu’actuellement le temps libre « consacré aux sciences » représente –toutes modalités comprises (TV, musée, lecture, pratiques amateurs..) un volume minime par rapport à celui de l’instruction scientifique initiale (voir figure 1 qui montre que l’on peut en estimer ce ratio à quelques pourcents).
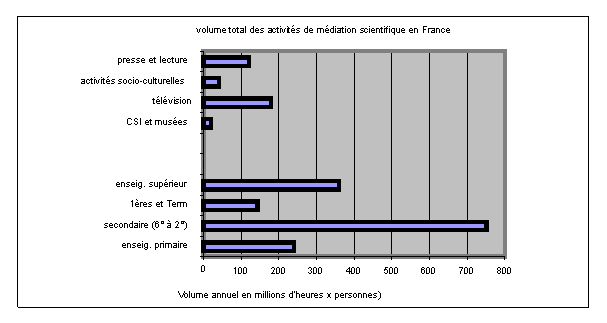
Figure 1 : on peut estimer le volume annuel d’action culturelle scientifique relevant du « temps choisi » des français (4 lignes du haut) à quelques pourcents (2,5% ici) du volume total de l’enseignement scolaire et universitaire de sciences (4 lignes du bas)
Donc, si le but est bel et bien le développement de la part « scientifique » de la culture de chacun, il faut indéniablement agir dans le système éducatif formel, particulièrement dans le secondaire, faute de quoi on se limite à rôle correctif au second ordre. Certes, des effets qualitatifs locaux sont constatés et de multiples exemples de réussite illustrent une telle efficacité à l’échelle de l’individu, du petit groupe, sur de petits territoires ou sur une thématique circonscrite. Mais, il en va tout autrement d’un point de vue social et quantitatif, où la corporation des acteurs de la culture scientifique qui s’est progressivement constituée ces dernières décennies se trouve cantonnée à un rôle sociologiquement secondaire dont elle n’a eu d’autre choix que de se satisfaire, souvent instrumentalisée et à l'affût des aubaines financières susceptibles de se présenter.
Alors, comment repenser l’organisation actuelle de l’enseignement scientifique secondaire ? Pourquoi ce chantier n’est-il pas une priorité première de l’institution éducative ? Quel est le cahier des charges de cet enseignement des sciences ? Il est, comme les instructions officielles l’indiquent, double : identifier et commencer à former la future élite techno scientifique (9% de scientifiques et ingénieurs et de 15% de techniciens) dont notre société a besoin et rendre les sciences « goûteuses » pour tous les autres, à savoir trois quart d’une classe d’âge (voir figure 1).
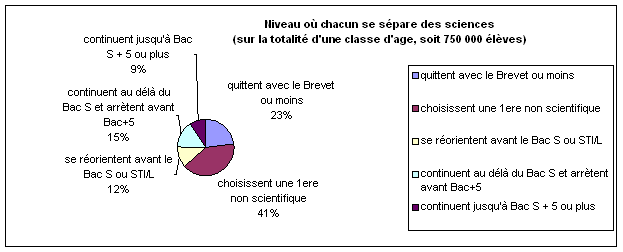
Figure 1 : 4 élèves sur 5 quittent les sciences avant le Bac S : la culture générale majoritaire est donc celles de ceux dont le secondaire n’a pas su développer le goût des sciences.
Or, la conclusion est simple : ce système est le principal responsable du manque de goût généralisé pour les sciences, parce qu’il n’arrive pas à remplir à la fois ces deux objectifs, pourtant bien identifiés mais trop diamétralement opposés : le premier induit l’existence d’un système de notation des performances qui se révèle vécu comme une obligation de renoncement aux sciences par ceux qui héritent des moins bonnes notes : « tu es mauvais en maths, en physique, mais tant pis, on en meure pas d’être nul en maths ou en physique ». On n’en meure pas, mais au lieu d’acquérir le goût des sciences, on risque surtout d’en acquérir le dégoût ; et de fait, c’est ce qui se passe pour une forte proportion des trois quarts de la population qui décrochent des sciences avant le Bac.
Pourrait-on se donner pas les moyens de mettre en place un système pédagogique différentié (ce que l’on arrive à construire dans des classes uniques par exemple) qui permettrait de remplir simultanément les deux familles d’objectifs ? Cela revient à se demander si l’enseignement des sciences pourrait être globalement capable d’assumer un rôle de « culture pour tous ». Un éclairage très significatif est donné par un rapport de l’inspection générale de l’éducation nationale[4] qui s’intéresse fin 2004 à l'enseignement en première L et ES, pourtant clairement orienté sur la "culture scientifique", n'arrive pas à se détacher d'un conception dogmatique classique de l'enseignement des sciences". « il faudrait pourtant que les enseignants prennent conscience que l’on peut prendre plus de temps pour la formation, la culture, le débat sans mettre en danger le résultat des épreuves. Au contraire, l’exercice de la réflexion permet une maturation plus efficace pour les élèves que cette recherche angoissée d’une exhaustivité qui prend comme référence idéale les contenus de la filière scientifique. (…) Mais c’est probablement en amont, dans les habitudes prises, qu’il faut rechercher et traiter les causes de cet échec : on n’assouplit pas d’un coup de baguette magique, dans une section spécifique, des regards qui mènent à confondre rigueur et rigidité, et à mépriser la science qui s’applique. La diversification pédagogique doit être mieux préparée en formation initiale. Cet enseignement montre aussi la difficulté qu’éprouve le système à mettre en oeuvre des objectifs dépassant l’élaboration de savoirs et de savoir-faire exclusivement disciplinaires. Ces classes ne sont d’ailleurs pas les seules concernées : plus largement, on peut se demander si les intentions culturelles explicites dans les programmes de première et de terminale sont prises en compte dans la formation, dans la mesure où elles ne passent pas au premier plan dans le cadre de l’évaluation. »
Ainsi donc, là où le cahier des charges privilégie sans ambiguïté la fonction culturelle et le « goût » du raisonnement scientifique, là où la fonction de formation des futurs scientifiques n’est pas à l’ordre du jour, l’enseignement scientifique n’arrive pas échapper à ses habitudes dogmatiques. Comment alors imaginer dans les classes antérieures, aux cahiers des charges moins monolithiques l’introduction systématique de pédagogies différentiées ? Et bien sûr, il n’est pas socio économiquement envisageable d’inverser les priorités éducatives entre produire le bon nombre de futurs cadres technoscientifiques ou développer le goût pour les sciences des trois quart d’autres. Moralité, l’action culturelle scientifique se trouve cantonnée à une fonction sociale corrective, alors même que ses objectifs et finalités déclarés restent beaucoup plus ambitieux « la science pour tous ! ». A minima, on pourrait alors espérer que les mouvements d’éducation populaire s’affirment comme ceux qui veulent favoriser l’appropriation des méthodes et productions scientifiques par les 75% qui en sont privés par l’enseignement secondaire actuel. Mais comme seules les actions de proximité (type ateliers d’éducation populaire et projets d’expo sciences) transforment réellement l’intérêt pour les sciences et qu’elles sont exigeantes en investissement, leur généralisation massive dépasse très largement les moyens des organisations concernées.
A l’exception des actions locales à fort investissement de terrain, les offres, aussi ouvertes soit-elles (Fête de la science, Nuits des étoiles..) se révèlent à l’usage toucher principalement des niches de publics déjà intéressés : les audiences de ces opérations ne croissent d’ailleurs plus depuis de nombreuses années. Et les rares cas où la curiosité ou l’inquiétude du plus large public se mobilise (éclipse de 1999, explosion toulousaine d’AZF, maladie orpheline d’un proche, Rubik’s Cube…), l’intérêt ne se maintient pas au-delà de l’événement qui la déclenche, à l’exception notable de rares processus d’empowerment comme ceux des militants d’Aides, dont il est à remarquer qu’ils concernent des sous populations spécifiques et qu’il échappent en quasi-totalité aux acteurs traditionnels de la « culture scientifique ». Faute d’être autre chose que des politiques de l’offre, les actions destinées à la sensibilisation du plus grand nombre se métamorphosent vite en action de renforcement de l’intérêt de ceux déjà intéressés, ce qui finalement se révèlent accroître les inégalités sociales plutôt que les réduire : profitent majoritairement des offres culturelles que ceux qui y sont déjà sensibles : les dernières éditions des « Nuits des étoiles » sont plutôt présentées par les journalistes comme l’occasion pour les passionnés d’astronomie de se retrouver que comme une opportunité à saisir par tous.
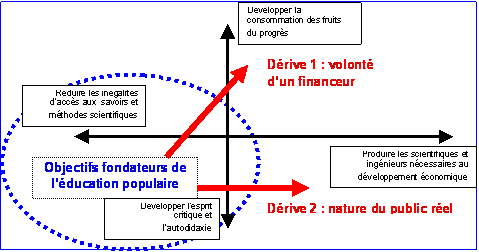
Figure 3 : dérives d’objectifs pour des actions d’éducation populaire : lla volonté d’un sponsor peut entraîner la dérive 1, le spectre réel de la clientèle d’une offre peut avoir pour effet la dérive 2.
Or, ainsi condamnée de fait à être socialement velléitaire, la corporation des acteurs culturels scientifiques parait être aujourd’hui bien installée dans un consensus mou, peu à même de se préoccuper de clarifier ou de mettre en cohérence ses objectifs. Ceux-ci apparaissent pourtant paradoxaux, caractérisés par une double opposition (réduction des inégalités pour certains et détection de l’élite scientifique pour d’autres, développement de l’esprit critique d’une part et consommation des fruits du progrès d’autre part, voir figure 3) et fortement sujet à des dérives susceptibles de produire des effets sociaux inverses à ceux souhaités, à savoir renforcer les inégalités d’accès aux savoirs, développer une consommation boulimique du progrès.
La question du manque de goût du plus grand nombre est d’ailleurs de manière quasiment systématique amalgamée avec celle –pourtant bien différente au plan social- de la formation des futurs spécialistes : à ce propos, les textes officiels et la plus part des acteurs se plaignent d’une présumée désaffection des études scientifiques, sans constater que celle-ci se révèle à l’examen n’être qu’un déplacement de flux, une part de plus en plus importante des bacheliers scientifiques préférant contourner les DEUG généralistes en empruntant des filières plus professionnalisantes, comme les DUT pour poursuivre ensuite vers les diplômes supérieurs dans une proportion constante depuis plus d’une décennies (voir la figure 1).
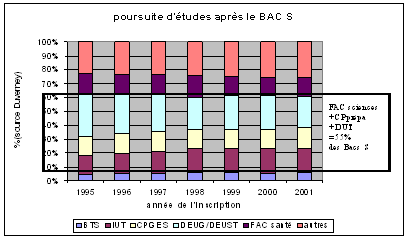
Figure 4 : Sachant que le nombre de Bac S reste constant, on vérifie ici que l’on ne constate pas de désaffection des études scientifiques, mais le fait que les étudiants préfèrent les DUT et classes préparatoires plutôt que les DEUG.
De fait, ces amalgames et ces dérives affaiblissent encore l’efficacité du projet de « la science pour tous ». Déjà inapte à un effet social global, incapable de peser au regard du dégoût de la science produit sur le plus grand nombre par l’enseignement initial, faute de les clarifier, la corporation de l’action culturelle scientifique peut voir dans ce consensus mou s’annihiler beaucoup de ses efforts.
En observant ces amalgames et le manque de détermination à changer radicalement l’échelle de la « mise en culture des sciences », on en vient à se dire que la fonction uniquement corrective par rapport à l’enseignement initial des sciences est peut-être de fait largement suffisante pour satisfaire nos décideurs. Vu sous cet angle, nous serions alignés sur le minimum nécessaire pour que les dégoûtés des sciences consomment quand même les fruits du progrès et que les choix technoscientifique soient entendus et acceptés démocratiquement, sans permettre en rien d’inverser l’image des sciences inaccessibles instaurée chez le plus grand nombre par l'instruction initiale. Et peut-être qu’au fond, il suffit que ce minimum de correction soit apporté pour que notre société de consommation technoscientifique fonctionne correctement et qu’a contrario, nos équilibres socio-économiques seraient brisés si l’on se consacrait avec trop de réussite à produire 100% de passionnés de sciences.
B : Sémantique des amalgames et
Remise en trois perspectives
Il est ainsi crucial que les différences et divergences entre les acteurs soient mises au jour. Avons nous la même représentation du « scientifique », de la « culture » ou de l’assemblage systématique du « scientifique et technique » ?
Quelle science ?
Autant d’ambiguïtés sur les objectifs viennent peut être de divergences sur la définition et la représentation de la science et de la scientificité. Paradoxalement, la question de la démarcation entre science et non science ne départage que marginalement les acteurs de l’action culturelle scientifique, lesquels ne s’interrogent qu’occasionnellement sur la place que doivent occuper les sciences dites humaines, et particulièrement celles qui le seraient trop dans leurs pratiques. A contrario, ils se différentient surtout par la « perspective » sous laquelle ils envisagent prioritairement l’activité scientifique, à savoir soit un corpus de savoir à apprendre (regard 1, celui des « disciplines scientifiques » porté par exemple par l’IGEN), soit des méthodes de résolution de problèmes utiles au quotidien et à l’émancipation individuelle (regard 2, celui de l’ « approche scientifique » porté par exemple par Planète sciences, dans une logique héritée des pédagogies constructivistes de Freinet, que nous désignerons par « perspective ) soit enfin un système socio-économique à contrôler (regard 3, celui du « processus techno scientifique » porté par exemple par la Fondation Sciences Citoyennes).
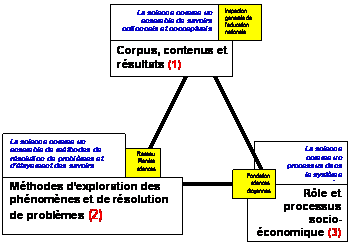
Figure 5 : Représentation des trois regards sur la science portés et véhiculés par différentes familles d’acteurs (des exemples d’acteurs étant donnés en jaune)
Ces deux dernières perspectives correspondent à deux projets d’émancipation, d’empowerment complémentaires mais bien distincts : l’un individuel et l’autre collectif sont Le premier, issu du regard 2 (approche scientifique) se propose de doter chaque personne de capacités et d’outils de réflexion et de résolution de ses propres problèmes. Il milite pour le développement de l’esprit critique et scientifique, permettant de distinguer croyances, convictions et savoirs étayés et de limiter l’effet d’arguments d’autorité infondés. Il se propose de donner des outils de construction critique de ses savoirs et de transformation de ses représentations. Le second, issu du regard 3 (processus technoscientifique à contrôler) vise surtout une transformation sociale. Il s’agit de permettre la régulation et le contrôle par les citoyens du développement technoscientifique et de ses impacts sur les humains et leurs organisations socio-économiques. Cette perspective est en fort développement aujourd’hui, s’inscrivant dans la volonté actuelle d'empêcher la croissance sans contrôle démocratique d’une « big science »[5].
Quelle culture ?
Loin de souhaiter l’instauration d’une « sous culture » scientifique séparée, les acteurs agissent pour le développement de la part scientifique de la culture générale. Malgré cela le vocable "culture scientifique" s’est imposé en France provoquant de multiples ambiguïtés et effets pervers, comme des inversions de priorités. Apparaît ainsi souvent comme première urgence la volonté de mettre de la science dans l’action culturelle et les "pratiques culturelles instituées". Remettre de la science dans la culture générale, ne passe pas forcément en priorité par le théâtre scientifique et renvoie à la question clef: si les sciences étaient revenues « en culture générale », en quoi cela se verrait-il ? Dans une telle utopie, qu’envisage-t-on de plus que les formes simplistes de consommation de produits culturels (visite d’une exposition, lecture d’un livre) ou de « pratiques amateurs » ou autodidactes ?
Si « de la science » avait vraiment été « mise » dans la culture, cela pourrait vouloir dire discuter sciences au bistrot, prendre part -en citoyen intéressé à exercer son esprit critique au service de la démocratie- aux débats d’orientation scientifique mais aussi invoquer naturellement méthodes et outils scientifiques dans la résolution de problèmes quotidiens : choisir le meilleur isolant pour son grenier, peaufiner son vélo et changer les pignons du dérailleur, améliorer sa guitare, acoustique ou électronique, se débrouiller d’un thermo siphon, créer des œuvres scientifiquement (en jouant sur la profondeur de champ, sur la vitesse d’obturation… en mélangeant des couleurs, en synthétisant des rythmes, des accords nouveaux, en remixant du mp3), jouer scientifiquement (au Rubik’s cube, au casino ou même en faisant des réussites, des mots fléchés avec son dictionnaire), se préoccuper du temps qu’il va faire scientifiquement (identifier les nuages, suivre le baromètre), jardiner… et construire un nichoir à oiseau, un cerf-volant, un pendule pour le plafond de la chambre du petit… Des dizaines d’heures de pratiques «cultivantes » en perspective. Et la prochaine grande marée pour aller aux crabes ? Et la prochaine pleine Lune ? Et le début du Ramadan ? La liste sera encore bien plus longue, si on ajoute un ordinateur et quelques périphériques dans le paysage. Il suffit d’aller faire un tour sur les forums des techno-bricoleurs ou des scientifiques amateurs pour en être submergé.
Et la situation des relations à la santé, des relations entre malades, « patients » pour reprendre l’expression traditionnelle, elle aussi condescendante sera sans doute bouleversée… Dans l’utopie de la science remise en culture, la médecine le serait aussi. Ainsi, on pourrait s’auto médicamenter scientifiquement, faire du sport scientifiquement (en suivant ses pulsations, en adaptant un entraînement fractionné), se mettre au régime scientifiquement (en suivant des ratio protéines/glucides…), discuter médecine et pronostic avec son médecin ou celui de sa grand-mère. Bref, la relation avec son médecin serait aussi équilibrée qu’avec son boulanger.
Mais peut-on vraiment croire à un système de soins sans pouvoir, sans rapport de force ? A l’instar de l’instruction publique qui a pour cahier de charges implicite de fabriquer 25% de technoscientifiques et d’adapter les classes d’âges à la hiérarchie socio-économique du marché de l’emploi, la santé publique n’aurait-elle pas aussi un cahier des charges implicite visant à faire respecter avec humilité aux « patients » la fatalité de la condition humaine, sauvant ceux qui peuvent l’être sans trop d’excès budgétaires.
Pourquoi scientifique et technique ?
Voilà qui conduit à revisiter l’amalgame "scientifique et technique". En effet, bien que les acteurs qualifient ainsi la culture qu’ils appellent de leurs vœux, ils n’investissent quasiment jamais ce champ des pratiques techniques et la majorité d’entre eux semblent utiliser cette expression comme un synonyme de « technoscientifique » voulant ainsi rappeler qu’aujourd’hui la science n’est autre que de la technoscience, non séparable de la dimension technologique, voire d’industrialisation. Il en résulte de fait une confiscation de la « culture technique » et une négation des « pratiques techniques » au sens traditionnel du terme.
Toutes les pratiques techniques traditionnelles ne seraient-elles alors que de la technique profane, indigne d’intéresser la « culture scientifique et technique » distinguée ? A contrario, à partir du moment où il y a modélisation, induction, déduction, observation, métrologie, ne s’agit il pas d’un symptôme de pratiques scientifiques potentielles ? Et si mettre les sciences en culture commençait justement par regarder aussi ces pratiques avec bienveillance et à aider les pratiquants à renforcer la dimension scientifique de leurs méthodes de résolution de problèmes ou dans leurs loisirs ? Ecrire des programmes informatiques, développer un bout de site en Flash, un blogue, traiter ses rosiers, réparer sa tondeuse à gazon… Certaines pratiques techniques de nos concitoyens, celles qui confrontent à observer, modéliser, tirer des conclusions, ne pourraient-elles pas être considérées comme ces introuvables pratiques culturelles scientifiques, justement profanes ou amateurs ?
C : Face au discrédit
de la perspective d’empowerment individuel,
plaidoyer pour des médiations ascendantes
Par opposition au point de vue scolaire et scolastique des corpus de sciences disciplinaires (regard 1 défini plus haut) les deux autres regards (regards 2 et 3) peuvent être qualifiés d’émancipateurs, respectivement au niveau individuel ou au niveau sociétal. Or, on trouve peu d’acteurs hybridant ces deux perspectives qui de fait ont donné naissance à des programmes d’action et à des idéologiques presque entièrement séparées. Le regard 2 a donné naissance à des pratiques de tâtonnements expérimentaux (Petits débrouillards) ou de projets de découverte scientifique (Planète science) qui se retrouve au sein de la famille du Cirasti, tandis que le regard 3 a développé des pratiques du type ateliers délibératifs, conférences de consensus ou café scientifiques.
En la matière, la situation actuelle est évolutive et préoccupante : la question du contrôle démocratique des choix techno scientifiques et les discours concernant le « développement durable » propulsent sur le devant de la scène le regard 3 « la science sous une perspective de système socio-économique », le regard 1 « la science sous une perspective de corpus disciplinaires » restant quant à lui solidement dominant chez les acteurs de l’enseignement initial. Le regard 2 qui lui vise aussi à l’appropriation d’une « approche scientifique » des questions individuelles et des problèmes quotidiens s’en retrouve relégué au second plan, y compris pour certaines organisations d’éducation populaire qui se tourne plus vers des formes de débats publics et moins vers des approches expérimentales concrètes : pour ces dernières, la nécessité démocratique d'un empowerment social[6] est tellement urgent, qu’il ne saurait attendre l’empowerment méthodologique des individus. Mais peut-on envisager l’un sans l’autre ?
De fait, on court aujourd’hui un grand risque à considérer ce regard 2 « la science sous une perspective de méthodes appropriables » comme n’ayant d’intérêt qu’au seul titre d’auxiliaire de l’école et du collège. En effet, s’il ne propose pas des situations concrètes de découverte des pratiques scientifiques phénoménologiques, le regard 3 en est réduit à des méthodes dogmatiques d’information et d’association des citoyens, même dans des ateliers délibératifs : faute d’ empowerment individuel, l’empowerment collectif est condamné à la démagogie.
Préciser cette question nécessite de clarifier ce qui peut être qualifié d’émancipation et de processus non dogmatique. Comme son étymologie le laisse transparaître, la posture traditionnelle de la vulgarisation est descendante, voire condescendante, et s’inscrit dans une logique d’adaptation, infantilisant celui qui reçoit le message. Se positionner dans une logique d’empowerment impose, a contrario, de s’intéresser aux stratégies de médiation dont la maîtrise est assurée par celui qui veut savoir, où le « sachant » ne fait plus les questions et les réponses reversant la logique de la vulgarisation au profit d’une logique ascendante. Décréter la fin du pouvoir du savoir, même à si petite échelle, est en effet illusoire, mais il est possible de chercher à l’équilibrer par le pouvoir sur le contrôle du processus. En donnant au "profane" le contrôle de la démarche de médiation, on prolonge les bases constructivistes des pédagogies actives. Cela conduit à refuser de définir le but de la médiation scientifique comme visant à "adapter les savoir pour les rendre accessibles" (définition de la vulgarisation par le Petit Robert) mais « plutôt à favoriser des pratiques autodidactes"[7].
D : Clinique des
pratiques ascendantes,
empowerment et développement de l’apprenance
Au delà du point de vue théorique, comment identifier ou construire de telles médiations « ascendantes » ? Comme elles imposent une demande consciente de savoir scientifique ou technique pour permettre l’appropriation de savoir, elles ne peuvent exister qu’en réponse à de la curiosité (c’est le champ traditionnel des loisirs scientifiques) ou à des préoccupations ou problèmes à résoudre (c’est celui, plus récent des cités de services ou boutiques de sciences, qui visent à aider à trouver des solutions ou des réponses, par des centres ressources ou des médiations type cités des métiers ou de la santé, forum ou chat technique ou santé sur le web). La curiosité génère les situations constructivistes des projets de "mini science" hérités de C. Freinet et de Claude Bernard dans des associations comme Planète sciences ou les Petits Débrouillards regroupées au sein du Cirasti. Les préoccupations individuelles génèrent des dispositifs d’empowerment ou d’écoute et conseil dérivés du concept des boutiques de science, mais orientées vers la réponse à l’individu, comme les cités des métiers ou de la santé.
Mais, bien sûr, il ne suffit pas de déclaration d’intentions. En pratiquant la critique (l'auto-critique en l’occurrence) de ces pratiques il est aisé de voir que la mini science des ateliers ou centres de vacances Planète-sciences ou Petits débrouillards ainsi que les premières tentatives ressemblant à des boutiques de sciences individuelles (les « cités de services » enfantées au sein de la cité des sciences et de l’industrie comme la cité de la santé par exemple) n’en sont en réalité qu’à leur premiers balbutiements.
En ce qui concerne ces dernières[8], la cité des métiers de Paris avec ses trois millions d’utilisateurs en 13 ans (sans oublier ses 17 petites sœurs essaimées du Brésil à l’Italie en passant par Belfort ou Barcelone), a fait ses preuves comme lieu d’écoute, de reformulation et d’appropriation d’information pour l’orientation, l’insertion et l’évolution professionnelle, mais sa fonction de passerelle vers des savoirs techniques ou scientifique, indéniablement voulue et affirmée, n’est ni prouvé ni facile à prouver : sans doute améliore-t-elle l’orientation et l’insertion et développe-t-elle aussi par la même occasion l’envie d’apprenance, mais son effet de mise en route d’une curiosité pour la science et la technique est secondaire. Son premier effet visible reste un empowerment social, première marche de l’éducation permanente, mais sans doute pas directement technoscientifique à court terme. Certes, il y a bien des utilisateurs qui s’engage dans un parcours d’appropriation technique ou technoscientifique où une question concernant leur vie professionnelle les conduit de la Cité des métiers à la médiathèque générale (un utilisateur sur trois) puis dans une exposition « culturelle scientifique ou technique », plus ou moins longtemps après. Mais le rôle principal d’empowerment technique, voire scientifique des Cités des métiers (toutes et pas seulement de celle de Paris) se joue à plus long terme dans leur capacité à déclencher l’envie de formation, l’apprenance, soit formellement au travers de la mise en route de VAE, DIF et autres bilan de compétences, soit plus informellement par des évolutions qui empruntent les voies plus diffuses de l’éducation permanente informelle. Il y a là une révolution copernicienne à opérer sur la représentation de la légitimité des Cités des métiers dans le paysage institutionnel de « l’action culturelle scientifique et technique ». Cette légitimité ne vient pas d’une capacité à faire passerelle à court terme vers des expositions scientifiques (le soir où on est venu chercher une info sur la VAE), mais d’un rôle à plus long terme de mise en mouvement vers une évolution professionnelle, vers un accroissement de la technicité et des compétences professionnelles de chaque utilisateur (lorsque dans le cadre de son parcours de VAE ou de création d’entreprise, quelques mois plus tard, on apprendra à dépanner un chauffe eau solaire ou à utiliser la norme ISO 14000).
Quant à la Cité de la santé elle est souvent regardée par le public comme une utopie étrange, indubitablement efficace au niveau du « counseling » individuel et de la démonstration préventive pour les groupes scolaires ou adultes cabossés ; en ce sens, il faut saluer sa contribution à l’émergence du concept de Maison des usagers des hôpitaux (comme à Saint Anne à Paris) et autres espaces culture santé dans des caisses d’assurance maladie (comme dans les Hauts de Seine). Collectivement, elle appartient bien à ce courant d’empowerment qui vise à transformer le rapport de force dominant entre soignant et soigné, mais force est de constater - au bout de quatre ans d’ouverture quotidienne - que l’appropriation de ces nouveaux lieux est bien lente.
Conscient qu’il n’est pas possible d’avoir raison trop tôt, nous n’avons pas encore osé en tester d’autres déclinaisons et nos rêves de cité du consommateur de technologie, cité de l’environnement, cité du bricolage… ne sont pour l’instant que des hypothèses sans échéance, dont l’économie n’est pas encore réellement formulable, sauf si nous osions les faire en ligne (tasanté.com et doctissimo.fr sont tellement plus dans l’air du temps et les nouvelles « pratiques culturelles que notre physique Cité de la santé) ou les inscrire radicalement dans une économie mixte. Indéniablement, la Cité du jardinage existe… chez Truffaut et Jardiland, celle du bricoleur… au BHV ou chez Bricorama.
Les pédagogies constructivistes de l’éducation populaire scientifique ne connaissent quant à elles qu’un développement limité. Planète sciences risque de se retrouver progressivement acculé à n’être qu’un auxiliaire du marché des compléments scolaires, sauf dans ses quelques clubs scientifiques, mais ceux-ci semblent toujours former plutôt de bons ingénieurs qui donneraient raison à TS Kuhn dans sa critique de la « science normale ». Parallèlement, les expos sciences du Cirasti sont alimentées par 60 % de projets périscolaires où les enseignants dogmatisent encore beaucoup ou au mieux, pratiquent une forme secondaire de dogmatisme en induisant des projets laissant peu d’autonomie aux jeunes. Quant aux réseaux d'échanges de savoir, aux « Study circles » et autres situations locales d’apprenance citoyenne à base ou non d’arbres de connaissance ou de time banks, bien que généralistes (non spécialisées en sciences cf projet www.scate.info), ils sont si rares que la question de la survie de l’utopie initiale de l'éducation populaire est posée : la grande étanchéité qui existe aujourd’hui avec les réseaux de l’éducation permanente –rebaptisée « lifelonglearning » en témoigne.
Voilà qui renvoie à la question des pratiques d’appropriation des savoirs explicitement affirmées comme de l’empowerment, visant à renverser un rapport de domination. Dans ce registre, on trouve les pratiques d’associations militantes comme AIDES ou d’acteurs sociaux comme la Confédération paysanne. Mais, au-delà d’un empowerment collectif, peut-on toujours aussi parler d’un empowerment de chaque individu ? Force est de constater malheureusement que les formes pédagogiques choisies restent souvent descendantes. Peut-être le développement viendra t-il alors des communautés des logiciels libres et autres encyclopédies autogérées, à la fois autodidactes et validées collectivement (comme Wikipédia, ou certains blogues interconnectés). C’est en effet dans ces creusets là que l’on entrevoit simultanément des dynamiques fertiles et un réel empowerment à la fois individuel et collectif.
Conclusion
Seule une modification en profondeur du système éducatif serait en mesure à terme de permettre une meilleure intégration des outils et méthodes scientifiques dans la culture générale de chacun. Pour cela, le système devrait acquérir la capacité de réussir simultanément dans la formation des 25% de futurs spécialistes et dans le développement de l’intérêt du plus grand nombre (les 75% autres pourcents) pour les outils scientifiques, capacité qui passe indubitablement par des pédagogies constructivistes et des affectations de moyens en conséquence.
A défaut, il continuera à produire une grande majorité de dé goûtés à qui des acteurs militants essayeront, pour encourager la consommation techno scientifique ou pour lutter contre toute forme d’obscurantisme, d’offrir un système de réparation culturelle. Et alors, le résultat de ce système ne pourra jamais être qu’au mieux correctif si l’on arrive à généraliser des pédagogies du projet expérimental et à créer des boutiques de sciences seconde génération, plates-formes d’empowerment émancipatrices, au service des individus. Sinon, il ne sera que palliatif avec une vulgarisation toujours condescendante, à base d’offres culturelles formulant à la fois les questions et les réponses et donc déconnectée d’une authentique demande sociale.
Post face : essayer de décrire l'utopie, ne serait-ce que pour objectiver les blocages
Pourquoi la coupure des
deux cultures semble-t-elle aujourd'hui à ce point irréversible ?
Nombreux sont ceux qui critiquent cette dichotomie ; mais qui oserait
aujourd’hui construire une utopie réconciliant cette séparation ? Au mieux,
trouve-t-on quelques défenseurs d’une hypothétique troisième culture, celle de
la sociologie, comme le propose Wolf Lepenies[9], …
encore plus de fragmentation. Pourquoi ne trouve-t-on personne pour oser
regarder si l’hypothèse d’une fusion des premières et terminales S et L afin
d’avoir une vraie formation générale, serait crédible. Réponse, a priori
imparable : la volume de connaissance. Trop de choses à savoir pour que
quiconque se risque à penser un tronc commun trop long. Jusqu’au Bac ? Vous n’y
pensez pas ! Le paradoxe est évident. Selon la plupart des auteurs, Derek Price
en tête, le volume de savoirs croit de manière exponentielle. Selon les
modèles, il semble doubler tous les quinze ou vingt ans. Or la durée de la
scolarisation des élites ne progresse absolument pas dans la même progression.
Bien sûr, il peut y avoir un peu de tassement… et une « métamorphisation » du
savoir de base qui se compacte et s’apprend plus vite. Mais force est de
constater que l’instruction publique a renoncé à se vouloir exhaustive.
Moralité la durée de l’enseignement et a fortiori son augmentation n’est plus
lié au volume de connaissances. Rien ne s’oppose donc à ce que l’on fusionne L
et S… Rien ? Ou alors des invariants plus profonds. Serait-ce simplement que
l’on ne saurait quoi faire d’une école de la réussite identique et égalitaire
pour tous ?